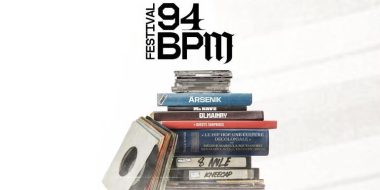Une dalle de béton et une bouche d’aération au milieu de la salle figurent un toit terrasse d’un immeuble de quartier populaire. Autour, des œuvres d’art occupent l’espace de la galerie Panoramas, monumental cube de métal posé sur le toit de l’espace culturel La Friche La Belle de Mai. Un des seuls endroits de Marseille à réunir à travers ses immenses baies vitrées à la fois la mer et les quartiers nord.
L’exposition « Comme un printemps, je serais nombreuse », fruit d’une réflexion entre le centre d’art Triangle-Astérides et la poétesse Sonia Chiambretto, propose le regard de huit plasticien.nes sur l’héritage des révoltes urbaines de 2005 successives à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré.
Il y a dans cette exposition une charge sociale et politique forte
« Les questions sociales existent beaucoup dans nos programmations », explique Victorine Grataloup, directrice du centre d’art. « Nous ne sommes pas un appareil idéologique d’État ni un endroit militant. Mais l’art est politique, et il y a dans cette exposition une charge sociale et politique forte, qui prend parti avec celles et ceux qui subissent les violences policières. Et qui exige qu’elles cessent. »
L’œuvre poétique de Sonia Chiambretto est la pièce centrale autour de laquelle les artistes se sont réunis pour interroger les rapports entre jeunes des quartiers populaires et autorité policière.
« Le titre de l’exposition est une citation tirée du texte que j’ai écrit pour ma pièce “Oasis Love” », explique l’autrice. « Elle arrive au moment où des adolescents, après avoir appris la mort de l’un d’eux entre les mains d’un policier, descendent dans la rue pour témoigner de leur colère et de leur désespoir. À la suite d’une course-poursuite, la peur laisse place à l’exaltation, et le personnage dit : “Comme un printemps, je serai nombreuse”, ce qui exprime à la fois la renaissance et le collectif. »
La veille du vernissage, Sonia apprend que l’épitaphe sur la tombe de Malik Oussekine, jeune français d’origine algérienne tué par des policiers en 1986, mentionne aussi le printemps, comme le titre de l’exposition. « Il y a gravé sur sa stèle “Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n’empêcheront pas la venue du printemps” [citation attribuée à Pablo Neruda, NLDR]. Ce lien m’a émue, je me dis que j’ai ressenti ce que beaucoup de monde touché directement par ces questions a ressenti. »

Dire le réel avec justesse
Comment toutefois évoquer une thématique si sensible avec justesse ? « Personne n’a la bonne réponse sur la manière de parler de la mort d’enfants entre les mains de la police », affirme Victorine Grataloup. « Chaque artiste apporte sa vision. On pourrait dire que c’est éthiquement compliqué de se saisir de ce sujet, mais nous pensons que le champ du symbolique qu’est l’art est important pour se réapproprier le réel. »
Dans l’exposition, aucune mention explicite à Zyed, Bouna, Nahel, et tous les autres dont la rencontre avec les forces de l’ordre aura été fatale. « On est pris en étau entre ceux qu’on cite souvent, ceux qu’on ne cite pas assez, et ceux dont on ne sait pas qu’ils ont été victimes, car la situation a été trop bien maquillée. Entre soucis de n’omettre personne et impossibilité de citer tout le monde », justifie la directrice. « Mais il faut à tout prix continuer de parler de ce qui s’est passé, et de ce qui continue de se passer. »
Les émeutiers créent de l’émotion, il y a une part émotionnelle incontestable
« Notre volonté, lors de la genèse du projet, était de réfléchir aux émeutes, à leur héritage. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? », questionne Sonia. Émeute, le mot est assumé. « Le moteur poétique de ma pièce se trouve dans le sens de ce mot, littéralement “créer de l’émotion”. Ce mot a été récupéré par les discours politiques, qui en ont fait une arme contre les manifestants », analyse-t-elle. « Je suis pour lui rendre son sens. Les émeutiers créent de l’émotion, il y a une part émotionnelle incontestable qui les fait sortir de chez eux après le meurtre d’un enfant. »
Cette « part émotionnelle » est soumise à l’expérience des visiteurs de l’exposition à travers des captations de ses textes diffusées dans des casques. Des mots chantés, susurrés ou scandés en cadence. « Mets tes mains en l’air ! Stop ! Pose tes mains sur la voiture ! Couche toi j’te dis, je vais tirer ! » hurlent deux voix, dans une musique au rythme ascensionnel qui frise la saturation.
Dans l’un des autres enregistrements, des enfants listent les qualités qu’aurait un « policier idéal ». « L’un d’entre eux dit qu’il le voudrait “moins raciste”, tu te rends compte ? Il y a une part de racisme qui est déjà perçue comme inéluctable », déplore Sonia Chiambretto.

Samir Laghouati-Rashwan au centre d’art Triangle-Astérides de Marseille. ©RamdanBezine
Une distance poétique libératrice
Près de l’entrée, de gros ours en peluches sont disposés au sol, vêtus de t-shirts floqués. « Fiché S » arbore l’un, quand l’autre exprime « Thugs don’t cry » (« les voyous ne pleurent pas »). Sur un troisième, on lit le titre de l’œuvre. « Let your thug cry » (« laisse pleurer ton voyou »). Une vidéo attenante montre le créateur de l’œuvre Samir Laghouati-Rashwan cagoulé, chaîne frappant son torse nu au rythme de mouvements suggestifs ralentis.
« Cet autoportrait version masculiniste fait écho aux messages sur les ours qui sont des projections très négatives qu’on fait sur nous. » Ce « nous », ce sont les jeunes hommes racisés des quartiers populaires. Lui vient du quartier Barriol à Arles. « 50 % de chômage, un peu comme la région parisienne, mais avec les opportunités de la capitale en moins. »
On se retrouve affublés de clichés qui participent à l’hypermasculinité malsaine
Son approche du thème de l’exposition part de l’intime. « Je parle de construction masculine. On se retrouve affublés de clichés qui participent à l’hypermasculinité malsaine imposée par le patriarcat, et dans laquelle on se projette nous-même dans une forme de racisme internalisé. Alors qu’au fond, on est des nounours », sourit Samir.
Sa manière volontairement « ludique » d’aborder le sujet est assumée. « En créant une pièce comme celle-ci sur un thème aussi lourd, je prends une distance poétique, ironique, qui m’autorise une certaine liberté pour aborder ces questions dans des institutions majoritairement blanches assez éloignées de ces problèmes. »
Une autre de ses œuvres, disponible sur Internet, ne s’embarrasse pas de chemins détournés pour évoquer les violences policières. Dans « Non-lieu », livre en ligne postfacé par Anas Daif, Samir Laghouati-Rashwan liste toutes les bavures fatales ayant abouti à un non-lieu depuis 1992, son année de naissance.
« Je note les noms des personnes tuées par la police par année, et tous les deux ans, je réaugmente avec les éventuelles nouvelles victimes », explique l’artiste. « Partir de ma naissance, c’est aussi compter le nombre d’années où je reste en vie, où mon nom ne figure pas sur cette liste, parce qu’il pourrait très bien y être. »

Lawrence Davis et Sonia Chiambretto à l’exposition « Comme un printemps, je serais nombreuse »/ ©RamdanBezine
La force des mots
« POLICE ! » Le soir du vernissage, la voix de Sonia Chiambretto déchire le silence de la salle d’exposition où une centaine de personnes assiste à sa performance. Debout sur le toit-terrasse, elle déclame un texte intitulé « Juste – Pas juste », écrit en 2009 suite à un épisode de violences policières dont elle a été témoin.
« J’étais en résidence dans un foyer pour jeunes filles à Saint-Ouen. Un après-midi, nous sommes allées nous balader avec Bintou, une adolescente et deux amies à elle. C’était un bel après-midi, on s’était acheté des bonbons et de l’Oasis à l’épicerie », se remémore-t-elle. « Soudain, un policier a violemment agressé un jeune devant nous, que Bintou a reconnu comme étant son cousin. Ensuite, les filles se sont disputées, insultées, c’était très nerveux, la violence est contagieuse. »
De retour au foyer, Bintou lui confie une perquisition au cours de laquelle son frère est arrêté. Sonia en tire le texte lu au micro. Les mots captent l’audience, et la traduction en anglais-américain faite par le comédien Lawrence Davis presque simultanément, en démontre leur triste universalité. Des œuvres exposées dans la galerie, les textes de Sonia Chiambretto sont les plus percutants, frontaux.
J’aime penser que les gens appréhendent mieux le réel à travers l’art
« Je me suis demandée comment mettre en musique, sublimer, rendre visible ce qui s’est passé sans l’esthétiser. La langue permet de versifier, donner du souffle, du rythme. » Et propose dès lors une narration incarnée, à rebours des discours médiatiques. « J’aime penser que les gens appréhendent mieux le réel à travers l’art, la littérature, qu’à travers les informations », résume-t-elle.

“Chant sur la mort des enfants”
Parmi les œuvres, le court-métrage de Virgil Vernier retient son attention. Intitulé « Kindertotenlieder » (« Chant sur la mort des enfants »), il compile des séquences de journaux télévisés de TF1 liées à la mort de Zyed et Bouna et aux révoltes. Particularité, les commentaires journalistiques sont retirés. Seules subsistent les images de terrain, les témoignages et les prises de paroles politiques.
Un récit s’instaure, sorte de dialogue de sourds entre une population fatiguée et une réponse politique autoritariste. « Ce film crée de la poésie, une forme de conversation apparaît une fois que les commentaires sont supprimés », note Sonia Chiambretto.
À l’image, les cocktails molotov illuminent la nuit, et le jour les yeux cernés des habitants prennent à partie la caméra, empreints de lassitude et de colère. Un père de famille regrette les événements, et pointe la responsabilité de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Celui-ci apparaît à l’écran lors d’une conférence de presse à l’allure martiale.
Hasard du calendrier, le jour même du vernissage de l’exposition, l’ancien président français, définitivement condamné à un an de prison pour « corruption » et « trafic d’influence », se voyait remettre par l’administration pénitentiaire un bracelet électronique.
Ramdan Bezine