Ce lundi 25 mars, c’est Me Meriem Ghenim qui gère la coordination de la permanence. Avocate en droit pénal depuis 2011, elle a plutôt l’habitude de défendre les mineurs. Parallèlement à cette spécialisation, elle « est de perm’ » au moins une fois par mois. « Ça me permet d’avoir une vision globale de la politique pénale menée par la juridiction », explique-t-elle.
Vers 8h30, l’avocate se rend au tribunal pour répartir les affaires aux membres de son équipe. Aujourd’hui, Me Karen Azria s’occupera des CRPC (convocation par reconnaissance préalable de culpabilité, ndlr), Me Ali Sidibé et Me Selim Mamlouk se chargeront quant à eux des comparutions immédiates. De son côté, Me Ghenim traitera les CPVJC (convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire, ndlr). Derrière ces acronymes complexes, il y a des gens à défendre rapidement, efficacement, humainement.
Après avoir fait le tour des greffes pour se présenter, elle part rencontrer « ses cinq gars » au dépôt. Par chance, la petite pièce du tribunal n’est pas bondée ce matin. Une fois revenue au bureau, elle attend un appel du procureur. « Il doit nous dire ce qu’il reproche aux prévenus », vulgarise-t-elle.

Me Meriem Ghenim, coordinatrice de la permanence des avocats commis d’office
Une course pour assurer la meilleure défense possible
Chaque matin, c’est la course. « On commence par regarder les évidences sur des aspects de nullité et ce dans chaque affaire », détaille-t-elle. Est-ce que les interpellations et les perquisitions se sont bien passées ? Est-ce que tout a été fait correctement ? Ensuite, les ACO peuvent s’attaquer « au fond du dossier », aux éléments à charge et à décharge. « Quand les prévenus reconnaissent leur culpabilité, on examine les conditions dans lesquelles ils ont avoué et on réfléchit aux sanctions à proposer », poursuit-elle. Dans le meilleur des scénarios, les avocats commis d’office obtiennent une nullité de la procédure ou démontrent le vide du dossier et plaident la relaxe.
Notre permanence est historique, c’est l’une des premières à avoir mis en place un système de défense collective structurée
« Notre permanence est historique, c’est l’une des premières à avoir mis en place un système de défense collective structurée », déclare avec fierté Me Virginie Marques, référente des coordinateurs. Pour gérer leur temps au mieux, les avocats qui la composent doivent prendre en compte l’envoi des notifications, l’échange avec les clients et la préparation du dossier. Cet équilibre est ténu : « Si on regarde trop vite, on risque de passer à côté d’éléments importants. »
Et lorsqu’il rencontre le prévenu, ce n’est pas toujours simple de créer un lien de confiance instantanément. « Il y a toujours un premier rapport compliqué, raconte la référente. On essaie de s’assurer qu’ils ont bien compris leurs droits et on tente de saisir le contexte du dossier. » Parfois, ils omettent des faits et testent leur défense sur les avocats. « Quand on est aguerri, on sait s’ils nous mentent », confie-t-elle. Quoi qu’il arrive, les ACO doivent suivre ce que dit leur client. « Si un prévenu clame qu’il est innocent, nous n’avons pas le droit d’aller à son encontre, même si tout le dossier prouve le contraire. »
On a fait les mêmes études, obtenu les mêmes diplômes, disposons de nos propres cabinets, simplement, on a peut-être un peu plus la rage qu’ailleurs
Avocat commis d’office par choix
Me Ghenim tient à casser les clichés autour des avocats commis d’office. « Une partie de l’opinion publique pense que nous sommes de mauvais avocats. Un peu comme dans les films américains, se désole Virginie Marques. Les prévenus, eux-mêmes, nous demandent souvent si nous sommes de “vrais avocats”. » Elle voudrait donc redorer la réputation de ses confrères et consœurs, régulièrement visés par un mépris de classe de la part des avocats de Paris. « On a fait les mêmes études, obtenu les mêmes diplômes, disposons de nos propres cabinets, simplement, on a peut-être un peu plus la rage qu’ailleurs », admet-elle.
Et pour cause, les ACO de Bobigny s’adaptent au terrain du 93, « le département le plus pauvre de France hors DROM-COM », souligne la référente. Une partie des avocats qui déambulent dans les couloirs du tribunal ont d’ailleurs grandi ici. Ce qui n’est pas toujours le cas des procureurs, notamment des plus jeunes, dont Bobigny est la première affectation. Une certaine méconnaissance de classe se ferait donc sentir dans leurs réquisitions. Face à cela, il y a des présidents de chambre qui prennent parfois le temps d’expliquer les choses aux prévenus. « Certains confrères le critiquent, car cela rallonge les audiences », indique la référente pour qui cette pédagogie reste « très précieuse. »
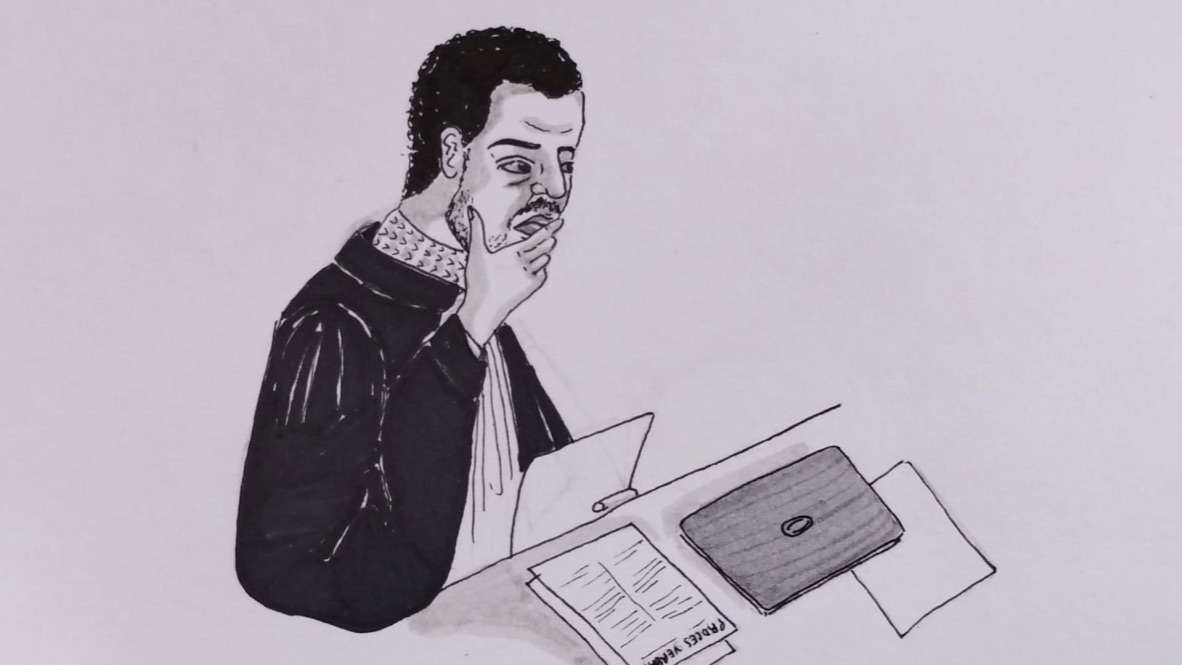
Me Ali Sidibé en audience
De moins en moins d’instructions
« Politiquement opposée aux comparutions immédiates », Me Ghenim. estime que « ce n’est pas normal de juger les gens dans ces conditions-là ». Elle doit néanmoins faire au mieux sur ce terrain précaire. Au fil des ans, Me Marques a, quant à elle, remarqué un « glissement » inquiétant vers une baisse des instructions au profit d’une augmentation des comparutions immédiates. Selon elle, ne plus instruire comporte un risque : celui d’affaiblir le pouvoir judiciaire. Cela envoie aussi le message que certaines affaires et certains prévenus ne vaudraient pas la peine qu’on débloque de l’argent et du temps pour eux.
Alors sur le terrain, les ACO font le grand écart et passent d’audiences pour des voies de fait à des affaires de proxénétisme. Me Sidibé et Me Mamlouk sont habitués à cette gymnastique mentale. « Au début, la permanence, c’est indispensable quand on veut faire du pénal », raconte Selim Mamlouk. « Moi, je la pratique comme un sport », ajoute-t-il. Pour Ali Sidibé, « il faut être prêt physiquement comme moralement, réactif et dynamique » car les comparutions immédiates sont intenses et requièrent de la ténacité. Notamment lorsqu’il s’agit de soulever des nullités dans la procédure.
On ne fait pas ça pour l’argent
« Parfois, on sent un peu d’exaspération quand on la questionne, confie Me Mamlouk. On a l’impression de déranger. » Lors d’une de ses audiences, justement, Me Sidibé a tenté de demander l’annulation de la procédure. Les policiers auraient insulté son client de « bledard » et de « bâtard », il n’aurait pas été nourri et n’aurait pas pu appeler un proche. Ce jour-là, il ne l’a pas obtenue.
En termes de rémunération, les ACO récupèrent l’aide juridictionnelle collectée par leur ordre. Mais la somme est dérisoire par rapport au travail fourni. « On ne fait pas ça pour l’argent », affirme Me Ghenim. Si la juridiction de Bobigny soutient au mieux sa permanence, le manque de moyens alloués à la justice se fait néanmoins sentir sur tout le territoire national.
Texte et illustrations : Marthe Chalard-Malgorn



