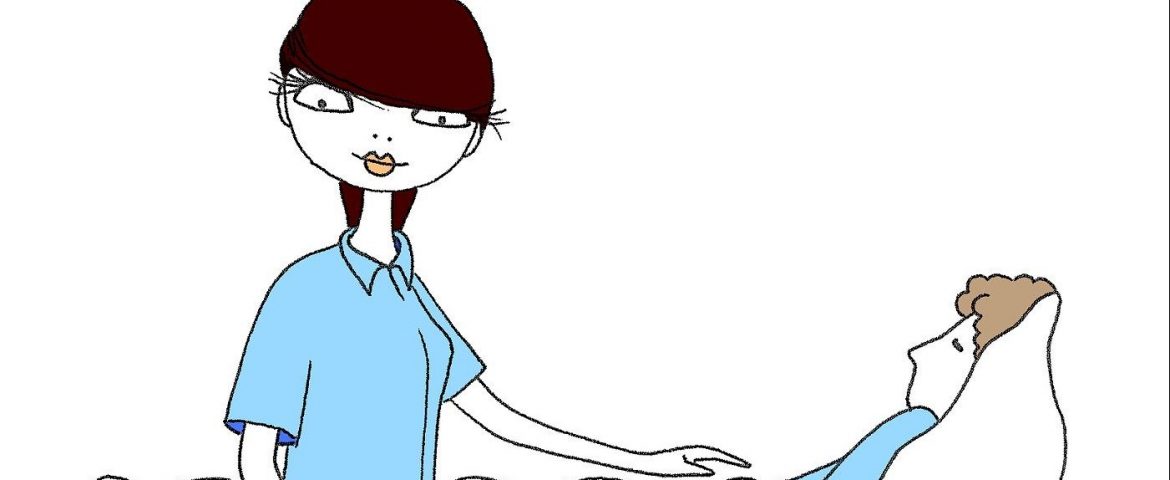Article initialement publié le 9 juin 2020
Sabrina se souviendra sûrement à vie de son début de carrière. Officieusement, cela fait trois ans que la jeune femme de 25 ans apprend le métier d’infirmière. Et trois mois qu’elle met en pratique tout ce qu’elle a appris au milieu de la plus grande crise sanitaire de l’histoire récente du pays.
Juste avant le début du confinement, elle a passé ses derniers examens, rendu son mémoire de fin d’études, trouvé son ultime stage. Et puis tout s’est bousculé avec la pandémie. Son stage a notamment été annulé. Pas question pour autant de chiller en pyjama sur Netflix : « Mon école a dû envoyer certains de ses élèves au front. J’ai déjà cumulé quelques expériences alors quand on m’a contactée pour me proposer d’aider dans cette crise, j’ai naturellement répondu présente. Ce n’était pas obligatoire mais je n’allais quand même pas rester chez moi les bras croisés ».
Une infirmière normale dans une période anormale
C’est comme ça que Sabrina s’est retrouvée, en blouse, dans plusieurs hôpitaux parisiens où elle alternait les gardes. A cause de son asthme, la jeune femme n’a pas pu intégrer les unités spécifiquement liées au Covid-19. Elle a été affectée « dans les services qu’on peut considérer comme ‘normaux’ en ce moment » : pédiatrie, cardiologie, cancérologie…
Ne pas soigner de malades infectés par le virus ne l’a pas empêchée d’y être directement exposée : « Combien de fois je me suis occupée de patients toute la nuit pour apprendre que 2 heures après mon départ, ils étaient testés positifs au coronavirus, raconte-t-elle. Idem pour les collègues malades. On mange ensemble, on partage les mêmes espaces et on apprend ensuite qu’untel l’avait. Ce sont les risques du métier comme on dit… »
On s’apprête à relancer la discussion, à dérouler nos questions mais Sabrina n’a pas tout à fait terminé : « Notre métier comporte des risques, on les connaît et on les accepte. Ce que je n’accepte pas, ce sont les conditions déplorables de travail. Déjà que dans les unités Covid, les protections étaient restreintes, t’imagines bien que dans les autres services c’était encore pire. La pénurie de masques était réelle, je me suis retrouvée plus d’une fois à court de masques, en pleine nuit. Je parle là de masques chirurgicaux évidemment ; les FFP2, j’en n’ai pas vu beaucoup. J’ai notamment travaillé dans une clinique privée du 93, c’était tellement la merde que pour gérer au mieux les stocks (si on peut appeler ça comme ça), les masques étaient dans le coffre-fort où l’on cache les drogues comme la morphine. C’était surréaliste. »
Sabrina habite encore chez ses parents, à Drancy. Ça ne se voit pas tout de suite avec sa petite taille et son visage juvénile mais elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Elle partageait jusqu’ici sa chambre avec une de ses petites soeurs. Cette dernière a subi plusieurs lourdes opérations et fait ainsi partie des personnes considérées « à risque » face au Covid-19.
Alors, Sabrina a déménagé au sous-sol de la maison : « Ça me permet de passer directement par là quand je rentre. Je me suis imposée un protocole strict : je mets du gel hydroalcoolique dans la voiture, je retire mes chaussures dehors, je me lave tout de suite les mains quand je rentre, je mets mes vêtements à la machine, je prends une douche tout de suite et là seulement je peux rejoindre les autres… Et encore, de loin. »
Si tu meurs t’auras aidé les autres, c’est bien, mais nous on t’aura perdue toi
Plus de bisous, de câlins ou de chamailleries entre frères et soeurs, Sabrina raconte que l’ambiance est étrange à la maison depuis le début de la pandémie : « En fait, c’est dur de trouver le juste milieu entre mes convictions professionnelles et cette sorte de culpabilité familiale. Je sais qu’à la maison on m’en veut un peu de travailler parce que je ne suis pas ‘obligée’ de le faire. Je sais que mes parents ont peur pour moi, peur que je transmette le virus à mes frères et soeurs. Ma mère me dit souvent ‘Si tu meurs t’auras aidé les autres, c’est bien, mais nous on t’aura perdue toi’… C’est dur de faire face à tout ça aussi ».
L’infirmière nous parle ensuite de la peur. Celle d’attraper le virus, celle de le transmettre, celle de ne plus pouvoir assurer ses permanences. Une peur qui n’est jamais partie très loin : « Je n’ai pas tellement peur en allant travailler mais plutôt sur le retour. Je me refais ma journée dans ma tête, j’essaye de me rappeler à chaque fois si je me suis bien protégée, est-ce que je ne vais pas refiler un truc à ma famille… Au moindre petit symptôme, je flippe à l’idée de rester clouée au lit, chez moi, proche des miens. Donc voilà, cette peur est là, tout le temps, mais on apprend à vivre avec. »
Sabrina a toujours voulu travailler dans le domaine médical. Les allers-retours à l’hôpital Necker pour sa petite soeur y sont pour beaucoup. Elle raconte que cette crise a confirmé qu’il s’agissait bien d’une vocation : « On est mal payé, peu considéré, il n’y a pas tellement d’avantages finalement. Alors oui, je pense que c’est un métier qui ne marche que par vocation. »
S’excuser d’être soi-même hospitalisée : check
Pour un souci de santé indépendant du Covid-19, elle a dû passer quelques jours à l’hôpital elle aussi, cette fois dans le rôle de la patiente. « C’est simple, ça a été la seule fois où j’ai pleuré depuis le début de cette crise, avoue-t-elle. Pourtant, je suis plutôt solide émotionnellement mais je m’en suis voulue d’être hospitalisée à cette période. J’ai carrément envoyé un message à ma cadre pour m’excuser. Je savais que mes collègues avaient besoin de renfort, alors il était insupportable de me retrouver impuissante. Certaines infirmières plus expérimentées me disent que c’est la ‘fraîcheur’, l’aspect ‘nouveau’, qui explique cette adrénaline. Peut-être bien. Une chose est sûre, j’espère que cette passion ne me quittera jamais ».
Autre événement qui l’aura marquée ces dernières semaines : cette nuit de garde où elle intercepte un patient qui s’apprête à sortir de sa chambre, sans raison particulière. « C’est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup, sourit-elle. Je n’ai fait que des gardes nocturnes et forcément la nuit, c’est relativement silencieux. Ce soir-là ce patient m’a surpris en ouvrant la porte de sa chambre brusquement. Je ne sais pas ce qu’il voulait faire mais je savais qu’il n’avait pas le droit de sortir. Et surtout, je savais qu’il avait partagé sa chambre avec un monsieur mort du corona. Alors, j’ai paniqué. J’ai eu peur, ça a été très vite dans ma tête : je n’étais pas équipée, je ne savais pas où il allait…
Je lui ai ordonné de rejoindre sa chambre le plus vite possible. Je lui ai parlé de manière vive et automatique. Moi, Sabrina, j’ai presque oublié d’être polie. Bah ça, tu vois, c’est tout bête hein mais j’y ai pensé pendant 15 jours. 15 vrais jours où j’ai cogité, culpabilisé. Finalement, je pense que c’est le contexte qui fait qu’on est poussé à bout. Certaines craquent et se mettent en arrêt. Je les comprends, c’est épuisant, entre le masque qui étouffe et les tenues qui tiennent chaud. Psychologiquement, c’est très dur ».
Une chose est sûre : on n’en peut plus
Malgré tout, Sabrina a tenu pendant cette période de crise. Elle a essentiellement travaillé la nuit d’ailleurs. Ses horaires ? 19h30-7h30 dans certains établissements, 21h30-7h dans d’autres. Intense pour un début de carrière. « C’est clair que c’est… formateur, glisse la jeune femme. A l’école, on nous prépare aux situations hardcore (sic), on est préparé à la mort par exemple, mais pas autant. Là, carrément on m’a déjà dit ‘Ne regarde pas par la fenêtre, il y a trop de morts’. »
Pour la jeune professionnelle qu’elle est, la situation est marquante. «Evidemment que c’est violent, reconnaît-elle. On fait ce métier pour sauver des vies, sauf que là on s’est retrouvé à accompagner les gens vers la mort. On a souvent été la dernière personne que le patient a côtoyée. Alors personnellement, j’ai essayé d’être là avec douceur et gentillesse. » Elle marque un temps d’arrêt et reprend : « Tu sais, on nous appelle ‘les petites mains du médecin’ mais non, je suis désolée, je ne suis pas une petite main moi. On est plus que ça. La plupart du temps, on est la psy, l’amie, la confidente. On connaît la famille du patient, le nom de son chien, où sont ses grains de beauté… et c’est souvent nous qui découvrons malheureusement le patient mort ».
Avec le recul de l’épidémie, le nombre de morts a chuté mais l’infirmière ne connaît pas encore le répit : « Je suis tellement épuisée… J’ai pris quelques jours de repos, je ne tenais plus. Continuer à ce stade-là, c’était irresponsable, j’avais peur de faire une connerie. S’il y a une deuxième vague, je ne sais pas comment on va faire. »
C’est vrai que cette discussion est passionnante mais elle aura duré trois heures. Beaucoup trop ? La retranscription fut longue, oui, mais en vérité on aurait pu continuer encore trois heures de plus tant Sabrina est captivante.
Et la politique dans tout ça ? En deux mots ? « En deux mots c’est impossible, en deux gros mots peut-être ?, dit-elle dans un fou rire. Non, plus sérieusement, cette reconnaissance doit avant être politique. Il n’est pas normal qu’on se soit retrouvé à court de masques, de médecins, de lits, de respirateurs, de tout. Il n’est pas normal que les multiples alertes, les manifestations récentes n’aient pas trouvé d’écho politique. Il n’est pas normal qu’un étudiant infirmier gagne 250 euros par mois. Il n’est pas normal qu’il faille une pandémie pareille pour que tout le monde réalise qu’on existe, tout simplement ». Tout simplement.
Sarah ICHOU